Introduction :
Dans le monde académique, la rigueur, la persévérance et la capacité à gérer des projets complexes sont des qualités souvent mises en avant. Cependant, pour certaines personnes, comme Ana Bastos, la route vers la réussite scientifique est semée d’embûches inattendues. Au-delà des défis habituels d’une carrière universitaire, Ana a dû composer avec des obstacles liés à sa santé mentale et, plus particulièrement, à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Bien que le TDAH soit souvent associé aux enfants, de nombreux adultes vivent avec cette condition sans en être conscients. Ana raconte comment elle a passé des années dans le brouillard, gérant mal son anxiété et sa fatigue, sans savoir qu’une partie de ces difficultés venait d’un diagnostic qu’elle ignorait. Elle décrit cette période comme une lutte constante pour rester concentrée et motivée, tandis que les exigences académiques ne cessaient de croître. Enseignement, gestion de plusieurs projets de recherche, nouvelles responsabilités de supervision, et adaptation à un nouveau pays : tout cela cumulait un poids immense sur ses épaules.
C’est finalement suite à un épisode de burnout qu’Ana a été diagnostiquée. Ce moment de révélation a été à la fois un choc et un soulagement. Pour la première fois, elle a pu mettre un nom sur ses difficultés et comprendre que son cerveau fonctionnait simplement différemment. Au lieu de se voir comme « mal adaptée », Ana a commencé à adopter une perspective plus bienveillante envers elle-même. Elle a réalisé que le TDAH n’était pas une limitation insurmontable, mais une composante de sa personnalité qui, bien gérée, pouvait même devenir une source de force.
Aujourd’hui, forte de cette prise de conscience, Ana partage son parcours et les stratégies qu’elle a mises en place pour exceller en tant que scientifique. Plutôt que de se battre contre ses caractéristiques neurodivergentes, elle a appris à les intégrer dans son quotidien. Elle nous livre ici des conseils précieux pour aider d’autres chercheurs, qu’ils soient neurotypiques ou neurodivergents, à naviguer dans le monde exigeant de la recherche académique.
1. Un diagnostic révélateur
Ana explique que son diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) a transformé sa vision d’elle-même. Loin de la considérer comme une limitation, elle a vu son TDAH comme un levier pour mieux comprendre son fonctionnement interne. Elle réalise que ses difficultés à gérer le stress, la fatigue et l’anxiété sont amplifiées par un environnement académique compétitif.
2. Le rôle essentiel de l’activité physique
Elle remarque que ses meilleurs moments de santé mentale coïncident avec une activité physique régulière. Que ce soit par le sport ou la danse, ces activités lui permettent de réduire l’anxiété et d’améliorer son sommeil. Elle conseille aux autres chercheurs de faire de l’exercice une priorité.
3. Gérer l’énergie plutôt que le temps
Les méthodes traditionnelles de gestion du temps ne fonctionnent pas toujours pour les personnes atteintes de TDAH. Ana préfère se concentrer sur la gestion de son énergie et de sa motivation en fixant des objectifs quotidiens réalistes, avec un grand objectif par jour, puis en ajustant selon ses niveaux d’attention.
4. Utiliser des motivateurs externes
Certains projets, comme la préparation de dossiers ou de présentations, peuvent être particulièrement complexes pour les cerveaux neurodivergents. Ana utilise des déclencheurs sensoriels — comme la musique, le thé et des objectifs de récompense — pour mobiliser sa concentration. Elle se fixe également des échéances personnelles pour se donner un sentiment d’urgence.
5. Créer un environnement organisé
Ana met en avant l’importance d’un espace de travail ordonné et d’un système de planification efficace. Elle garde toujours son agenda à portée de main, notant chaque idée et échéance. Pour les grands projets, elle les décompose en petites tâches, ce qui les rend plus accessibles.
6. Chercher du soutien et des alliés
L’environnement académique peut être solitaire, surtout pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale. Ana insiste sur l’importance de consulter un professionnel de la santé et d’obtenir un soutien thérapeutique. Elle souligne également l’importance des collègues et mentors de confiance.
7. Accepter les nouveaux défis pas à pas
Chaque étape de sa carrière apporte de nouvelles responsabilités. Elle accepte que chaque transition prenne du temps et exige des ajustements. Elle encourage les autres à être indulgents avec eux-mêmes et à progresser progressivement, sans se fixer des attentes irréalistes.
Conclusion : Promouvoir un environnement inclusif en recherche
Pour Ana, une carrière scientifique est un choix enrichissant pour les esprits curieux, créatifs et tenaces. Elle plaide pour des environnements de travail inclusifs où les diverses manières de penser et de collaborer sont reconnues et valorisées. Une approche inclusive bénéficierait autant aux neurotypiques qu’aux neurodivergents.
Référence :
Bastos, A. (2024). Comment j’apprends à naviguer dans le monde académique en tant que personne avec TDAH. Nature. Disponible ici : https://doi.org/10.1038/d41586-024-02911-7
Je t’invite à me suivre pour recevoir d’autres articles et vidéos sur la thèse :
Et n’oublie pas, nous sommes de vaillants doctorants prêts à se donner les moyens de réussir notre thèse !
À cœur vaillant, rien d’impossible !
Cyprien


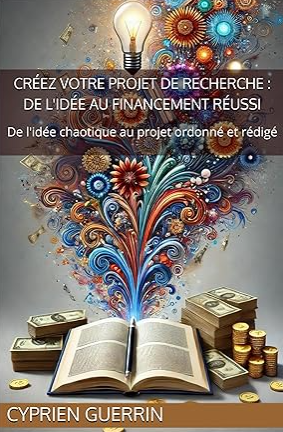
Donne moi ton avis en commentaires !