Le parcours doctoral est jonché de défis, mais certaines erreurs courantes peuvent transformer ce voyage en une véritable impasse. Ces mauvaises habitudes, que beaucoup de doctorants développent, finissent par nuire à leur productivité, à leur bien-être, et à la qualité de leur travail. Il est facile de tomber dans ces pièges, surtout quand la pression monte, mais en étant conscient de ces écueils, vous pouvez les éviter et garder le cap. Voici les 7 mauvaises habitudes que tout doctorant devrait éviter pour mener à bien son doctorat. Je suis tombé sur un poste Reddit et je pensais le partager plus en détail avec vous.
1. Essayer de plaire à tout prix à ses encadrants
De nombreux doctorants tombent dans le piège de vouloir à tout prix plaire à leurs directeurs de thèse, au point de négliger leur propre autonomie intellectuelle. Bien sûr, l’avis de votre directeur est essentiel, mais tenter constamment de lui plaire sans oser exprimer vos propres idées ou doutes peut freiner votre progression.
- Conséquences : Cette habitude mène souvent à une perte d’initiative et à une dépendance excessive vis-à-vis du directeur. Vous risquez de vous éloigner de vos propres intérêts de recherche, simplement pour suivre les préférences de votre encadrant.
- Solution : Il est important de trouver un équilibre entre accepter les conseils et avoir la confiance nécessaire pour défendre vos idées. Vos recherches sont avant tout les vôtres ; développez votre voix et n’ayez pas peur de proposer des directions innovantes, même si elles divergent légèrement des recommandations initiales.
2. Ne pas parler pour soi-même
Ne pas défendre ses propres intérêts ou rester silencieux face aux désaccords est une erreur fréquente. Les doctorants ont parfois peur de contredire leur directeur de thèse ou d’autres membres de leur comité, mais cette réticence à s’exprimer peut entraîner une stagnation.
- Conséquences : Ne pas parler pour vous-même peut mener à des malentendus, des attentes irréalistes ou même à une mauvaise orientation de votre projet. En fin de compte, vous pourriez vous retrouver à poursuivre un travail qui ne vous passionne pas ou qui n’est pas aligné avec vos objectifs.
- Solution : Apprenez à exprimer vos besoins et vos limites de manière respectueuse, mais ferme. Un dialogue honnête et ouvert peut non seulement clarifier les choses, mais aussi renforcer la collaboration avec votre encadrant et les autres parties prenantes de votre recherche.
3. Mettre le bonheur des autres avant le sien
Il est naturel de vouloir maintenir de bonnes relations avec vos collègues, vos encadrants ou même votre famille. Cependant, certains doctorants tombent dans le piège de se sacrifier pour plaire aux autres, au détriment de leur propre bien-être.
- Conséquences : Cette habitude peut conduire à l’épuisement, à la frustration et à une déconnexion par rapport à votre propre motivation. Si vous vous concentrez uniquement sur ce que les autres attendent de vous, vous risquez de négliger vos propres besoins, tant sur le plan professionnel que personnel.
- Solution : Prendre soin de soi est essentiel pour rester productif à long terme. Apprenez à dire non quand cela est nécessaire, et assurez-vous de réserver du temps pour vous-même, que ce soit pour vous reposer, socialiser ou vous adonner à des activités qui vous apportent de la satisfaction en dehors de vos recherches.
4. Procrastiner en raison d’un manque de structure
La procrastination est l’un des plus grands ennemis des doctorants. Beaucoup restent tard sur le campus ou à la maison avec de bonnes intentions, mais finissent par perdre du temps sur les réseaux sociaux, dans des distractions numériques, ou même dans des tâches secondaires qui leur donnent l’impression d’être occupés, alors qu’elles n’apportent rien de concret à l’avancement de leur thèse.
- Conséquences : Cela crée un cycle vicieux de culpabilité et de frustration. Le doctorant se couche tard, se réveille fatigué, et entame une nouvelle journée sans avoir accompli ce qu’il avait prévu. La productivité baisse et l’estime de soi en prend un coup.
- Solution : Pour surmonter la procrastination, établissez une routine stricte et des objectifs clairs. Utilisez des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro, et dédiez des créneaux horaires spécifiques à vos recherches. Bannissez les distractions pendant ces périodes de travail.
5. Ne pas assumer ses responsabilités
Certains doctorants adoptent une approche passive, attendant qu’une « illumination » ou un moment « eureka » se produise pour avancer dans leurs recherches. Cette attitude peut être le résultat d’une peur de l’échec ou d’un manque de confiance en soi, mais elle peut conduire à une stagnation pendant des mois.
- Conséquences : Attendre passivement que des idées ou des solutions se présentent sans prendre des actions concrètes ralentit considérablement le processus de recherche. Cela peut entraîner une perte de temps précieux et un sentiment d’inachèvement.
- Solution : La recherche est un processus actif. Prenez l’initiative de tester des hypothèses, de consulter des experts et de vous engager pleinement dans le travail. Acceptez que l’échec fait partie intégrante du processus de recherche et utilisez-le comme une opportunité d’apprentissage plutôt que de le redouter.
6. Se laisser distraire par d’autres tâches non liées à la thèse
Beaucoup de doctorants se laissent facilement distraire par des tâches annexes qui leur procurent une satisfaction immédiate, comme des activités rémunérées, des collaborations secondaires ou encore des demandes d’aide de collègues. Ces activités, bien que souvent valorisantes, peuvent reléguer la thèse au second plan.
- Conséquences : Si vous passez plus de temps à travailler sur des tâches secondaires qu’à avancer dans votre propre projet de recherche, votre thèse risque de stagner. Vous pourriez ressentir un sentiment d’accomplissement dans ces autres domaines, mais cela ne vous rapprochera pas de l’obtention de votre diplôme.
- Solution : Fixez des priorités claires et ne prenez pas d’engagements qui pourraient nuire à votre progression. Il est important de savoir dire non à des distractions professionnelles ou personnelles qui ne sont pas alignées avec vos objectifs académiques.
7. Se comparer inutilement aux autres
Dans l’ère numérique, il est facile de comparer sa propre progression à celle des autres. Certains doctorants passent trop de temps à analyser les profils Google Scholar des chercheurs qu’ils rencontrent dans la littérature, ou à comparer leur production scientifique à celle de leurs pairs. Ce processus peut rapidement devenir toxique.
- Conséquences : Se comparer constamment aux autres peut générer un sentiment d’infériorité ou de découragement. Au lieu de se concentrer sur son propre travail, le doctorant peut être obsédé par le succès des autres, ce qui finit par saboter sa propre motivation.
- Solution : Rappelez-vous que chaque parcours doctoral est unique. Plutôt que de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès. Fixez-vous des objectifs personnels réalistes et célébrez vos petites victoires tout au long du processus.
Conclusion
Les mauvaises habitudes peuvent transformer le parcours doctoral en un chemin semé d’embûches, mais en étant conscient de ces comportements contre-productifs, vous pouvez les corriger avant qu’ils ne deviennent un obstacle majeur. Le doctorat est un exercice de persévérance, d’autonomie et de gestion personnelle. En évitant ces 7 mauvaises habitudes, vous augmentez vos chances de réussir non seulement académiquement, mais aussi de maintenir un équilibre de vie sain et satisfaisant.
Je t’invite à me suivre pour recevoir d’autres articles et vidéos sur la thèse :
- Sur la chaîne YouTube
- La chaîne Telegram des Vaillants Doctorants
- Rejoindre le groupe privé Facebook
- Le cercle des doctorants (Telegram)
- Canal Discord des doctorants
Et n’oublie pas, nous sommes de vaillants doctorants prêts à se donner les moyens de réussir notre thèse !
À cœur vaillant, rien d’impossible !
Cyprien


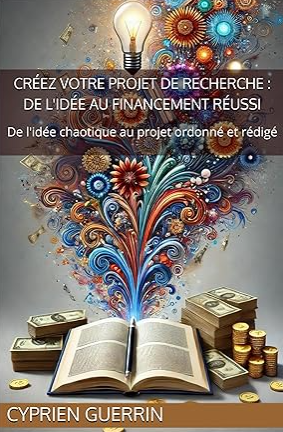
Donne moi ton avis en commentaires !