Dans cet article, je souhaite rassembler et partager certains enseignements que j’ai tirés du Professeur Didier Raoult sur la recherche et les découvertes scientifiques. Nous avons la chance de pouvoir nous inspirer d’un chercheur dont les contributions à la science, aussi profondes que diversifiées, ont contribué significativement son domaine. Au travers de ses livres et publications, tels que La science est un sport de combat et Homo Chaoticus, Professeur Raoult partage ses expériences et ses réflexions sur la pratique scientifique et la nature des découvertes.
Professeur Raoult se définit comme un renégat et partage les idées de figures intellectuelles telles que Karl Popper et Thomas Kuhn, ainsi que son expérience personnelle en tant que chercheur. Il nous plonge dans l’essence même des découvertes scientifiques. Ses idées peuvent servir de source d’inspiration pour innover dans nos propres recherches et questionner au-delà des sentiers battus.
J’aime lire et écouter régulièrement ses conseils pour les garder à l’esprit dans ma propre recherche, intégrant ainsi des principes fondamentaux dans mon quotidien de chercheur. Ce faisant, je m’efforce de ne pas simplement suivre les chemins tracés mais de chercher constamment à innover et à remettre en question les paradigmes établis. Ces moments de relecture sont cruciaux : ils me permettent de maintenir une perspective fraîche et audacieuse, essentielle pour repousser les limites de la science actuelle.
À travers cet article, j’espère transmettre les réflexions de Prof. Raoult qui ont enrichi ma perspective scientifique et, je l’espère, apporteront également une valeur ajoutée à la vôtre. J’espère que ses mots vous inspireront tout autant qu’ils continuent de résonner avec moi, enrichissant ainsi votre propre parcours scientifique et vous ouvrant à l’exploration de nouvelles avenues dans vos recherches et stimulant des découvertes qui pourraient redéfinir notre compréhension du monde scientifique.
I. Naviguer dans l’Incertitude Scientifique
1. L’ignorance et le scientifique ?
Nous sommes ignorants. Non seulement par nos outils qui limitent notre vision du monde, mais aussi à cause de nos théories que nous avons érigées avec une arrogance telle qu’elle nous empêche de voir et d’intégrer ce qui est juste sous nos yeux. Cette arrogance nous rend réticents à changer nos théories antérieures. C’est une dure réalité à admettre, que nous sommes influencés par les idéologies du moment. En effet, chacun combat l’ignorance à sa façon : à travers la religion, les idéologies… mais cela doit rester des opinions personnelles et non une thèse imposée. Les opinions ne doivent pas être considéré comme la réalité et imposée aux autres. Nous devons prioriser le raisonnement basé sur des faits démontrables et reproductibles.
Ainsi, aucune théorie scientifique ne doit devenir un dogme. Chaque scientifique doit être prêt à abandonner ses croyances si une meilleure théorie émerge ou si un nouvel élément scientifique est découvert. Les théories scientifiques n’ont pas besoin d’être vraies ou durables ; elles doivent simplement être utiles à un moment donné pour interpréter de nouvelles données. « Je considère les théories scientifiques avec un grand détachement, y compris les miennes. Personnellement, je n’ai aucun scrupule adopter une théorie scientifique qui permet à un moment d’expliquer les données que j’ai sous les yeux et d’en avoir une autre quelques mois après, si les données évoluent, » affirme Prof. Raoult. Nous sommes même contraints, comme tous les scientifiques actuels, d’utiliser les outils et les concepts de théories scientifiques désormais dépassées. Les théories scientifiques évoluent rapidement sous l’effet de l’accumulation constante de nouvelles données, et ainsi, les nouvelles théories n’ont qu’une durée de vie très courte. « Ce n’est pas choquant car, encore une fois, je ne crois pas être capable, je pense que personne ne l’est, d’avoir une théorie totalisante qui ne laisse pas place à l’explosion d’exceptions, qui vont rapidement mettre en péril la théorie. » Il faut donc prendre les théories scientifiques avec beaucoup de neutralité.
Sydney Brenner disait, « Je traite les théories scientifiques comme des maîtresses, je les désire mais ne les aime pas. Et je les abandonne lorsqu’elles ne me donnent plus de plaisir. » Et comme Philip K. Dick l’a formulé, « La réalité, c’est ce qui continue d’exister lorsqu’on cesse d’y croire. »
Comme le disait Friedrich Nietzsche, le scientifique doit briser le cœur respectueux envers son maître. Il ne faut pas hésiter à remettre en question les théories de nos maîtres les plus respectés, même si nous les admirons. Sans cette capacité à détruire les anciennes théories ou à détecter les éléments négligés par nos prédécesseurs, nous sommes incapables de voir et donc incapables de découvrir.
Cette ignorance devrait nous inciter à ne nous prononcer sur l’avenir qu’en précisant qu’il s’agit d’une simple opinion, qui, malgré notre connaissance, n’a pas beaucoup plus de chance de se réaliser que n’importe quelle autre. Nous utilisons des modèles réductionnistes qui visent à répliquer nos observations en laboratoire, supposant ainsi que nous possédons les connaissances nécessaires pour obtenir un modèle applicable à la vraie vie. Comme le suggère Éric Bapteste, « on ne peut pas plus prédire le passé que l’avenir parce qu’il nous manque autant d’éléments. »
Nous devons être constamment conscients que nos connaissances ne représentent qu’une partie de la réalité. Nous devons inviter l’ignorance, elle est inévitable ; elle est la marque de notre liberté et le moteur de notre recherche. Comme Socrate le disait, « Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien. » Nous sommes tous des ignorants, et bien que nous en sachions plus aujourd’hui qu’il y a mille ans ou même vingt ans, nous devons rester conscients de notre ignorance. Un scientifique doit constamment prendre conscience de son niveau d’ignorance pour ne pas être aveuglé à la découverte. Nous devons être en permanence capable de voir que ce qu’on nous a appris ne représente qu’une partie de la réalité. Nous resterons toujours ignorants d’une partie des choses. C’est la conscience de notre ignorance qui fait notre liberté et le gout de la recherche.
Descartes nous enseignait : « Dubito, ergo sum » – je doute, donc je suis. Ainsi, le scientifique doit constamment douter. Il faut apprendre à douter de tout, surtout si on n’a pas vérifié soi-même. Le doute est la seule preuve de la pensée, et le scepticisme est intrinsèque à la science. Dans la plupart des cas, ce que je pensais comme étant naturel ou spontané était faux et simplement le fait de mon ignorance (Prof. Raoult). Comme Nietzsche le notait, l’esprit de contradiction et une joyeuse raillerie sont des signes de santé ; toute forme d’absolu est une pathologie. Le scientifique doit constamment envisager de nouveaux angles, faire tomber les barrières et ne jamais être conventionnel, sauf s’il arrête la recherche, qui est fondée sur la contradiction et le doute.
Connaître l’étendue de sa propre ignorance afin de l’exploiter est essentiel dans la recherche. Plus nous sommes conscients de notre ignorance — non pas comme témoin de notre incompétence mais comme limite de la connaissance en général —, plus nous sommes ouverts à la possibilité de découvrir des choses inattendues. Reconnaître l’étendue de notre ignorance nous permet d’organiser nos vies et nos pensées et d’empêcher que l’on nous contraigne inutilement. Se poser constamment la question « Qu’est-ce que je ne sais pas ? » permet de cerner l’étendue de son ignorance. La reconnaissance de notre propre ignorance est essentielle dans la recherche scientifique, nous rendant plus ouverts à la possibilité de découvrir des choses inattendues.
Nous devons prioriser un raisonnement basé sur des faits démontrables et reproductibles. L’ignorance peut se manifester soit par une simplification excessive d’un fait, soit par une complexification pseudo-savante. Cette dernière est bien illustrée par le principe du rasoir d’Occam, une référence au moine scientifique anglais de la fin du Moyen Âge, Guillaume d’Occam, qui postulait que la théorie la plus simple est généralement la plus exacte. « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité », ce qui signifie qu’il ne faut pas envisager plusieurs causes quand une seule suffit pour expliquer un phénomène.
La connaissance future devrait nous aider à sortir des schématisations et des obligations simplistes souvent imposées au nom d’une logique généraliste qui n’existe pas dans les sciences biologiques. La reconnaissance de notre ignorance nous donne la liberté d’agir, d’organiser nos vies et nos pensées, et d’empêcher que des contraintes non fondées nous soient imposées. J’espère contribuer à la prise de conscience de notre ignorance pour mieux naviguer dans le complexe paysage de la science.
Il faut développer la qualité de reconnaissance de son ignorance, en disant « Je ne sais pas, mais je crois que… » Cela permet de faire la distinction entre notre savoir actuel et notre opinion, une qualité rare mais essentielle. Avec les enfants, par exemple, adopter une approche honnête en disant : « Je ne sais pas… mais je vais te dire ce que je crois, ce que l’on en pense maintenant, mon opinion… » permet de distinguer clairement le savoir de l’opinion à un moment donné. Comme le souligne Prof. Raoult, le bon sens et les évidences sont souvent trompeurs, et ce qui paraissait comme du bon sens est finalement souvent faux. Rien n’est jamais évident ; les choses sont démontrées ou ne le sont pas.
2. Érudition, spécialisation et indépendance du chemin suivi
Nous ne devons pas homogénéiser la pensée scientifique, et c’est pour cela qu’il ne faut pas que les étudiants se spécialisent trop tôt. Cette diversité dans la spécialisation attire des scientifiques de différents horizons, enrichissant ainsi la pensée collective, essentielle en période de révolution scientifique.
L’érudition vise à développer une compréhension aussi complète que possible d’un domaine spécifique. L’approfondissement de la connaissance nécessite que si l’on y consacre du temps. La réalisation d’une thèse, qui implique de consacrer au moins trois ans à étudier en détail un domaine restreint, offre cette opportunité. L’objectif d’une thèse est précisément de cultiver cette érudition. Ces longues années d’étude développent non seulement la capacité à penser, mais aussi à réfléchir sur le monde, ouvrant ainsi la voie à une vision plus large et plus riche.
Informés en profondeur sur de nombreux aspects d’un sujet, les érudits développent souvent une humilité quant à leur capacité à tout savoir. Cette humilité résulte uniquement d’un travail acharné. Cette volonté de travailler découle du plaisir, que certain ne peuvent pas comprendre, de générer de l’estime de soi en approfondissant ses connaissances et en atteignant des objectifs ambitieux.
3. La dépendance au sentier : l’importance de sortir des sentiers battus
Il est crucial d’apprendre à sortir des sentiers battus pour pouvoir découvrir des choses intelligentes. Cela est extrêmement difficile, comme chacun de nous peut le constater lors de promenades en forêt ou dans un champ, où nous sommes irrésistiblement attirés par le sentier déjà existant. En sciences juridiques et sociales, ce phénomène est désigné par l’expression « path dependence », qui décrit comment les pratiques passées influencent inconsciemment nos actions présentes, se perpétuant d’elles-mêmes.
« En équitation, en groupe, à la campagne, les chevaux français ont une volonté ferme d’avancer au même rythme et en se suivant très précisément les uns les autres sur le même sentier. J’ai horreur de cela car je veux rester maître de ma destination et j’ai beaucoup gêné ma famille en forçant mon cheval à sortir du chemin tracé par son prédécesseur, ou à l’obliger à faire du galop quand les autres faisaient du trot, et vice versa. En France, c’est difficile car les chevaux utilisés pour les balades sont moutonniers et ont une mentalité grégaire. Quand l’un part au galop, les autres suivent, même sans l’avis du cavalier. Aux USA, les chevaux se comportent différemment. Chacun va à son allure comme il le souhaite, sans que les autres chevaux s’en émeuvent. Chacun évolue à son propre rythme de manière individuelle. »
4. La Chance en Recherche Scientifique
La chance joue un rôle essentiel dans la découverte scientifique, comme l’illustre bien le proverbe de Virgile : « Audaces fortuna juvat » (la chance sourit aux audacieux). Louis Pasteur affirmait également que « la chance sourit à l’esprit préparé ». Cette perspective souligne l’importance de se mettre dans des conditions propices à la chance pour bénéficier pleinement de ses opportunités.
Cependant, la chance seule ne suffit pas ; il est crucial d’organiser les résultats obtenus, de les sécuriser et de les transformer en quelque chose d’utile et admissible par la communauté scientifique. Le facteur chance distingue particulièrement la recherche exploratoire de la recherche fondée sur des hypothèses préétablies. Selon le Prof. Raoult, tandis que la recherche exploratoire nous prépare à être surpris, la recherche hypothétique peut parfois nous enfermer dans nos propres opinions préconçues.
En incarnant le rôle du découvreur, celui qui est ouvert à l’inattendu, nous pouvons véritablement exploiter la chance. Le chercheur cherche ce qui est attendu, mais le découvreur trouve l’inattendu. Souvent, les grandes découvertes sont le résultat d’observations fortuites. Par exemple, la découverte de la protéine fluorescente verte (GFP) a été une telle surprise. . Il faut toujours chercher, et parfois regarder dans la « poubelle » de la science pour trouver ce qui est inattendu. Les découvreurs accueillent avec enthousiasme ce qui sort de l’ordinaire, car ce qui est attendu ne fait généralement que confirmer ce que l’on sait déjà. Les découvertes sont souvent le résultat d’une observation inattendue, comme la découverte de la GFP (protéine fluorescente verte). La véritable découverte vient de l’attention portée à l’inattendu, car ce qui est attendu ne fait que confirmer une hypothèse préexistante. C’est cela être un découvreur. Un chercheur, lui cherche ce qui est attendu, le découvreur lui trouve l’inattendu.
Louis Pasteur a également démontré que le hasard pouvait jouer un rôle crucial dans les découvertes scientifiques. Lors de ses travaux sur le vaccin contre le choléra des poules, il a observé que la souche de la bactérie Pasteurella multocida, cultivée dans des conditions où sa virulence était inutile, devenait moins virulente. Ce hasard a mené à une augmentation de son efficacité vaccinale. Pasteur a gardé des poules initialement infectées pour un autre essai, et lorsqu’il a utilisé une souche peu cultivée en laboratoire pour une nouvelle infection, les nouvelles poules sont mortes du choléra, tandis que les premières semblaient protégées, jetant ainsi les bases de la vaccination moderne.
5. Le conflit, moteur de la science
Héraclite affirmait que « Polemos (le conflit) est le père de toutes choses et de tous les rois, » soulignant ainsi que le conflit est au cœur de toute création, tant dans l’histoire que dans la nature. Cette notion trouve un écho particulier dans le domaine scientifique où les conflits sont non seulement inévitables mais essentiels. Ils sont intrinsèques au progrès de la connaissance. Si une idée et ce que l’on écrit (publications) ne suscite pas de débat, c’est probablement parce que son importance est marginale. Plus la réaction à une idée est violente, plus cela révèle que la question est importante.
Les conflits scientifiques reflètent souvent la personnalité de leurs auteurs. Bien qu’ils puissent être douloureux, ils sont nécessaires car ils nous obligent à reconsidérer nos réflexions, à enrichir nos arguments pour démontrer ou convaincre. Pratiquer la science en sachant qu’elle peut engendrer des conflits, surtout lorsqu’elle remet en question des éléments essentiels aux théories dominantes, nous oblige à être extrêmement prudents quant à la qualité des données que nous manipulons. C’est une démarche exaltante.
La contradiction est un élément majeur de la connaissance scientifique. Cultiver un esprit de contradiction, et encourager ce trait chez les jeunes chercheurs, est une pratique que je valorise (Prof. Raoult). Par exemple, je donne régulièrement à mes internes un sujet sur lequel j’émet un avis et je leur demande de prouver le contraire en s’appuyant sur la littérature scientifique. Cet exercice développe leur esprit critique et les forme à être des renégats comme moi. Si leurs arguments sont solides, je suis prêt à renier mes hypothèses et avis, mais seulement sous la puissance d’éléments nouveaux, sous l’éclairage de la connaissance.
6. La nature du changement
Selon Héraclite, rien n’est immuable dans l’univers : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Cela signifie que tout est en mouvement permanent ; rien n’est stable ; les êtres vivants et les sociétés sont des entités mouvantes. De plus, Héraclite affirmait que « La foudre gouverne, » illustrant comment les événements chaotiques et imprévisibles peuvent radicalement transformer le cours de l’histoire. Des cataclysmes comme le déluge biblique, la destruction de Sodome et Gomorrhe, ou la confusion de la Tour de Babel sont des exemples de ces forces destructrices qui créent des goulots d’étranglement évolutifs. Ces périodes de crise sont souvent suivies de renaissances, comme après la disparition des dinosaures, qui a entrainé le boom des mammifères. Ces événements peuvent être vus comme des goulots d’étranglement dans l’évolution, où la population se réduit, la diversité diminue, avant de repartir en explosion.
Cela est aussi visible dans des périodes historiques comme la domination de l’Occident après la peste noire (qui a décimé 30 % de la population), suivie par les Trente Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, avec un boom démographique, de nouvelles conquêtes géographiques, et un épanouissement scientifique et artistique.
Galilée, reprenant cette idée, énonce que « La vérité est fille du temps », soulignant que notre compréhension de la vérité évolue avec les changements et les découvertes au fil du temps. Ainsi, tenter de prédire l’avenir avec certitude est futile, car l’histoire est modelée par des éléments imprévisibles et souvent chaotiques.
Ainsi, on ne peut rien prédire ! Ceux qui font des prédictions sont fous.
II. L’Observateur et ses Biais
La vie consiste à observer et acquérir des données nouvelles. Observer est la base de toute théorie scientifique. Cependant, cela n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. L’observation n’est pas neutre. Nous faisons un tri, en fonction de nos propres biais, pour ne garder que ce qui correspond à nos théories et à nos perceptions. Francis Bacon discute de ce phénomène dans ses écrits sur les idoles, où il explique comment nos préjugés façonnent notre compréhension du monde.
Francis Bacon affirmait : « L’aveuglement est notre incapacité à observer de façon neutre. »
Les données que nous collectons varient en fonction des circonstances, de l’environnement et des appareils de mesure utilisés. Par exemple, la mesure de la côte ou de la longueur de notre intestin peut dépendre du niveau de la mer ou du degré de précision recherché.
En biologie, c’est l’observateur qui crée l’idée que ce qu’il observe est mort ou vivant. Prenons l’exemple du chat de Schrödinger : à l’échelle macroscopique, le chat peut sembler mort, mais à l’échelle microscopique, il y a des signes de vie, comme des microbes résistant au poison et aux radiations. La définition même de la vie est spécifique et complexe. Certaines bactéries, comme Deinococcus radiodurans, illustrent bien cette complexité : même après la décomposition de son matériel génétique, cette bactérie possède des enzymes capables de réparer les gènes endommagés et de reconstituer graduellement son génome. Finalement, la bactérie demeure vivante et peut se multiplier de nouveau.
Ces exemples soulignent l’importance de reconnaître et de comprendre nos biais lors de la collecte et de l’analyse des données scientifiques pour ne pas fausser notre perception de la réalité.
Max Planck : « La vérité ne s’impose pas, mais ses adversaires meurent. » Ainsi, les biais sont forts et résistent. Les gardiens du temple, des théories ancestrales résistent au changement. En tant que chercheur, il faut oser donner un avis différents, même si nous sommes traités de complotistes.
1. Idola Tribus : La Subjectivité Humaine dans la Perception
Protagoras affirmait : « L’homme est la mesure de toutes choses. » Cette assertion, reprise à sa manière par Coluche qui disait « on juge avec ce qu’on a », souligne que chacun interprète le monde depuis son propre point de vue. Ainsi, notre perception du monde n’est jamais neutre et est intrinsèquement personnelle. Notre perception n’est jamais neutre ; elle est façonnée par nos visions intérieures et nos expériences passées, influençant notre capacité à interpréter clairement les événements qui nous entourent.
Notre perception du monde n’est pas neutre ; elle est intégrée, transformée et comparée par analogie avec le contenu de nos visions intérieures ou expériences passées. Cette approche contribue à notre aveuglement et explique pourquoi nous pouvons être confrontés à des événements extrêmement clairs sans les percevoir, ce qui peut nous empêcher de noter une information pertinente.
Cette subjectivité est ancrée dans notre nature humaine, qui nous incite à structurer le monde selon ce que nous sommes et comprenant nos propres biais et préjugés. Ces idoles de la tribu nous poussent à organiser et diviser le monde en catégories binaires : gauche contre droite, normal contre pathologique, bien contre mal. Cette dualité se reflète même dans notre biologie, comme nos deux mains, et elle se prolonge dans des domaines tels que la médecine, avec le normal et le pathologique, sans place pour l’entre deux. D’autres biais incluant le spectre des couleurs, ou encore nos systèmes de comptage existent.
La dichotomie peut aussi mener à l’ignorance et à l’arrogance, illustrée par l’usage des questionnaires à choix multiples (QCM) dans l’éducation. Ce format, qui force le choix entre oui et non, suggère qu’il n’y a pas d’ambiguïté entre le oui et le non et encourage les certitudes infondées ou les réponses aléatoires, empêchant la reconnaissance de l’ignorance. De même, dans les débats publics, on invite souvent une personne pour et une contre, quel que soit le sujet – féminisme, théorie du genre, vaccination, usage des antibiotiques – renforçant cette polarisation simpliste qui est rarement vraie.
Cependant, rien n’est aussi simple qu’il n’y paraît, rien n’est jamais tout noir ou tout blanc. La réduction des questions complexes à des dualités simplistes limite notre capacité à développer une pensée critique, essentielle pour faire avancer la connaissance de manière constructive et nuancée.
2. Idola Theatri : Les règles du jeu de notre société
Souvent autoritaires, nos sociétés imposent des tabous et des limites—juridiques, religieuses, culturelles—dans lesquelles le chercheur est immergé. Nous jouons, selon les stoïciens, notre « pièce de théâtre». Notre théâtre a des règles que nous ne définissons pas, et nous ne choisissons pas notre décor.
Par exemple, les théories de l’évolution de Darwin devaient être compatibles avec une vision post-biblique. Les idées politiques influencent également ce qui est promu ou rejeté. Durant la guerre froide, par exemple, deux théories se sont affrontées : l’inné versus l’acquis. Les communistes et la gauche prônaient l’acquis, tandis que la droite défendait l’inné. Les médias aiment avoir un camp du bien contre le camp du mal, voulant rejetant la pensée divergentes, tout devenant complotiste s’il ne tient pas dans le cadre.
Francis Bacon : « L’aveuglement est notre incapacité à observer de façon neutre. » Notre éducation et nos expériences passées façonnent nos perspectives, créant des biais qui influencent notre perception des informations et nous empêchent de voir chaque information de manière neutre. Cependant, cette « joie du débutant » nous permet de voir chaque chose une vue naïve et fraîche, essentielle au changement et à la découverte. Souvent, les plus grandes découvertes sont faites par ceux qui ont osé changer de domaine, apportant ainsi une nouvelle perspective. Les scientifiques doivent constamment s’aventurer dans de nouveaux terrains avec un œil neuf, ce qui permet non seulement de découvrir de nouvelles méthodes, mais aussi de défier et de questionner les normes établies. Cette approche est cruciale pour briser les conventions et repousser les frontières de la connaissance.
Albert Einstein observait : « On ne peut voir que ce que la théorie permet. » La théorie dominante nous aveugle souvent et nous empêche de percevoir certaines réalités. La théorie scientifique doit être capable d’intégrer les éléments connus, mais la recherche est un processus de questionnement continu. Il est donc essentiel de pouvoir dépasser les théories actuelles pour faire avancer la science.
3. Idola Specus : Les Idoles de la Caverne
Les Idola Specus, ou idoles de la caverne, représentent les biais personnels façonnés par notre histoire individuelle, marquée par divers éléments personnels et souvent, des conflits d’intérêts. Un exemple flagrant de ces conflits est celui des individus payés à 100% par l’industrie, qui peuvent manquer d’objectivité concernant des sujets susceptibles d’affecter leur employeur, positivement ou négativement. Ces conflits d’intérêts se manifestent également dans le domaine de la publication scientifique. Par exemple, si un journal scientifique est majoritairement financé par une industrie, cela peut influencer sa ligne éditoriale et les études qu’il choisit de publier.
Les Idola Specus sont donc ces biais d’observation et de perception qui peuvent nous empêcher de voir le monde sans œillères, influençant notre capacité à évaluer et interpréter les informations de manière neutre et objective. Ces idoles soulignent l’importance de reconnaître et de contrôler nos préjugés personnels et conflits d’intérêts pour atteindre une compréhension plus claire et plus honnête de notre environnement.
4. Idola Fori : Les Idoles du Forum
Les idoles du forum, celles qui se basent sur ce qui est dit publiquement et notre manière de parler, sont influencées par le discours dominants. Il ne faut pas se laisser biaiser par les appellations. Ces mots employés au forum, en discussion publiques, emprisonnent les concepts et les idées, les réduisant à une simplicité trompeuse. Tout est plus complexe que les noms donnés, il faut aller au-delà.
Le langage façonne notre compréhension du monde. Lorsque des mots descriptifs acquièrent une charge affective, comme le mot « Nigga », qui étymologiquement signifie simplement « noir », mais qui a acquis un caractère péjoratif, ils modifient notre perception de la réalité. Les descriptions réductrices, comme « peau blanche » ou « peau noire », ne rendent pas justice à la diversité réelle des teintes de peau, qui varie bien au-delà de ces catégorisations simplistes. L’utilisation de certains mots comme « noir » ou « blanc » dans des contextes culturels spécifiques peut également emprisonner les concepts.
Nos définitions et terminologies, souvent imprécises et inexactes, peuvent par aveuglement nous empêcher de voir la réalité telle qu’elle est. Prenons l’exemple des procaryotes, définis comme n’ayant pas de noyau ; cette définition est remise en question lorsqu’on observe des structures nucléoïdes complexes. De même, le terme « virus » a souvent été associé aux adjectifs « virulent » et « ultrafiltrable », excluant ainsi les virus géants des classifications traditionnelles. André Lwoff, lauréat du prix Nobel 1965, répondait à la question « Qu’est-ce qu’un virus ? » par « Un virus, c’est un virus », démontrant qu’un terme ne peut se définir en répétant le même terme.
De même, le terme « antibiotique » va bien au-delà de son étymologie, affectant non seulement les bactéries mais aussi ayant des effets sur les virus, la réduction de l’inflammation, et même certains troubles psychiatriques, comme illustré par l’utilisation de la minocycline. C’est pour cela qu’il faut oser retester des anciens médicaments.
Le nom donné aux enzymes peut également orienter de manière erronée notre compréhension de leurs fonctions. Si nous nommons une enzyme de manière à indiquer qu’elle « coupe les liaisons alpha », cela peut induire en erreur en suggérant que cette enzyme n’est impliquée que dans ce seul processus, alors que sa fonction peut être bien plus diversifiée.
Un exemple notable de ce phénomène est celui de la vasopressine, également connue sous le nom d’hormone antidiurétique. Bien qu’il s’agisse de la même molécule, elle a été désignée par deux noms différents car ses deux fonctions principales—réguler la rétention d’eau et influencer la pression artérielle—ont été découvertes simultanément. Ce double nommage souligne comment une seule substance peut jouer plusieurs rôles cruciaux, démontrant la complexité et la polyvalence des biomolécules dans notre corps.
Le terme de « drogue » peut aussi amener confusion. Une « drogue » est souvent perçu comme une substance illégale, mais en réalité, la classification des substances psychoactives (comme le tabac, l’alcool, le sucre ou même les benzodiazépines) relève d’une perception et d’un contexte social. Le terme « drogue » est souvent trop simpliste pour aborder des phénomènes aussi complexes. Les contextes culturels et sociaux influencent grandement la classification des drogues, comme le montre l’exemple de l’opium, autrefois considéré comme non addictif, contribuant ainsi à la crise des opioïdes qui persiste aux États-Unis.
Ces exemples démontrent que les mots que nous utilisons pour décrire le monde ont un pouvoir considérable sur notre compréhension des phénomènes. Il est donc essentiel de remettre en question et de retester les définitions et les classifications pour une meilleure compréhension et adaptation aux réalités complexes.
Ainsi, il faut faire attention aux mots et à leur définition qui peut non seulement restreindre, mais aussi amener dans à faire fausse route et empêcher de réaliser certaines choses.
5. Idola Quare : L’idole du POURQUOI
Didier Raoult a introduit l’idole du POURQUOI, qui souligne une tendance à rechercher des explications scientifiques immédiates à toute chose. Si cette quête de compréhension est un moteur essentiel et indispensable à l’avancement scientifique, elle peut aussi devenir un obstacle lorsqu’elle nous empêche de reconnaître et de voir ce que nous ne pouvons pas encore expliquer. Cette rationalisation à outrance peut nous conduire à croire que seules existent les choses que nous pouvons comprendre, alors qu’en réalité, l’existence des phénomènes ne dépend ni de notre capacité à les comprendre ni à les observer.
Cette inversion dans la démarche scientifique, où l’explication précède l’observation, peut être considérée comme l’une des formes d’aveuglement scientifique les plus marquantes du XXe siècle. La condition préalable de devoir comprendre pour pouvoir observer limite significativement la portée de la recherche.
De nombreux chercheurs n’arrivent pas à accepter les observations qui ne correspondent pas à un modèle compréhensible ou logique, ce qui crée une dichotomie dans le monde scientifique entre les découvreurs—ceux qui se lancent dans l’inconnu sans préconceptions/ les pécheurs embarquant sans savoir ce qu’ils vont trouver—et ceux qui bâtissent leur recherche sur des hypothèses prédéfinies. Ces derniers supposent souvent que les observations doivent se conformer à une explication commune et unifiée, et fondent leur travail sur cette base.
Bien que les deux approches contribuent à la progression de la science, Didier Raoult privilégie l’approche des découvreurs. Il se définit lui-même plus comme un « homme du quoi » (what man) que du « pourquoi » (why man), mettant l’accent sur l’importance de l’observation pure—le « quoi », ce que l’on voit—plutôt que de se perdre dans la quête incessante des raisons sous-jacentes. Ainsi, il développe son gout de l’observation au lieu de la question de savoir pourquoi.
6. Le biais de l’hypothèse
Lorsqu’on se concentre sur la validation d’une hypothèse, un risque majeur apparaît : celui de créer un biais qui nous pousse à rejeter tout résultat contredisant notre théorie, tout en favorisant ceux qui la confirment. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de l’hypothèse. Il nous fait douter uniquement de ce qui s’oppose à notre théorie, compromettant ainsi l’objectivité nécessaire à une recherche rigoureuse.
7. Le biais de l’interrogatoire
Un autre biais notable est celui de l’interrogatoire, particulièrement pertinent lorsqu’on interroge des individus sur des facteurs de risque. La fiabilité des informations recueillies est souvent faible, car les personnes interrogées peuvent mentir, oublier, ou ne pas se rendre compte de leur comportement réel, comme il est difficile de rapporter avec exactitude sa consommation d’alcool ou ses habitudes alimentaires.
8. Le biais des méthodes
Les méthodes conventionnelles utilisées pour définir des troubles psychologiques, tels que le test de préférence pour le sucrose ou le test des plates-formes élevées (EPM), tendent à simplifier des concepts complexes comme la dépression ou l’anxiété en les réduisant à des variables simples et mesurables. Ces troubles, cependant, sont en réalité bien plus complexes et multidimensionnels.
Pour surmonter ces limites, il est impératif de développer de nouveaux outils de mesure. Ces innovations permettent non seulement de changer notre manière de voir les choses mais aussi de conduire à l’émergence de nouveaux concepts. Didier Raoult souligne que nos outils de mesure définissent les limites de ce que nous pouvons observer, car il est impossible de représenter la réalité dans toute sa complexité avec les méthodes actuelles. Les nouvelles approches méthodologiques sont donc essentielles pour avancer dans la compréhension des phénomènes complexes et amener à de nouvelles découvertes scientifiques.
III. Deux types de découvertes : Curiosité vs. Hypothèse
Dans le domaine scientifique, l’arrivée de nouveaux outils permet d’explorer et de révéler des phénomènes auparavant invisibles. Une fois ces nouvelles observations réalisées, il est crucial de faire appel à l’esprit critique pour développer des recherches fondées sur des hypothèses. Cette dualité entre la recherche guidée par la curiosité, souvent technologique, et celle basée sur l’hypothèse est cyclique et essentielle pour le progrès scientifique.
Par hypothèse, certains pensent qu’il est possible de réaliser d’importantes découvertes en accumulant un maximum de savoir dans son cerveau et en déduisant des hypothèses auxquelles personne n’avait pensé. Toutefois, cette approche est de plus en plus remise en question et décrédibilisé en raison de son inadéquation avec la complexité de notre monde. Le Professeur Raoult exprime des doutes concernant la recherche « mécanistique » en laboratoire, en raison des biais et des conflits d’intérêts qui peuvent fausser les résultats.
Les résultats d’une expérience que l’on a menée pour confirmer un fait ont surtout un intérêt quand ils ne correspondent pas à ce que l’on attendait. En effet, on biaise tellement les données expérimentales lors de travaux préliminaires (pour orienter vers une réponse positive) que l’on enlève beaucoup de sens à la démonstration scientifique. « La force de croyance de ceux qui ont une recherche fondée sur les hypothèses est très importante puisque leur processus scientifique découle de l’expression de leur pensée, de leur âme, si j’ose dire. » Ceux qui s’appuient fortement sur les hypothèses ont donc tendance à défendre ardemment leurs idées et point de vue, parfois au point de donner des explications contraires à la théorie du d’Ockham.
Le Professeur Raoult préfère une recherche fondée sur la curiosité et l’utilisation de nouveaux outils, qu’il trouve plus gratifiante et stimulante. Cette approche attire les scientifiques guidés par la soif de découverte, la curiosité, la gourmandise, l’appétit. Les découvreurs savent bien que d’autres découvreurs trouveront d’autres choses, qui compléteront, changeront la manière dont ils ont vu les choses. Les découvreurs, tant qu’ils ont de l’appétit pour la découverte, continuent à découvrir quand les périodes le permettent.
Cependant, le développement de grands outils, comme les centres de séquençage de plus en plus performants, peut mener à une recherche où l’analyse critique et la créativité sont absentes, se résumant à une simple accumulation de données brutes. Ces données sont souvent exploitées par d’autres chercheurs, et peuvent aboutir à des publications prestigieuses, mais manquent souvent de véritable analyse intellectuelle et créatrice, ou même une simple analyse de résultats. Il ne suffit pas de découvrir des choses, il faut ensuite analyser ce que l’on a trouvé et essayer de l’intégrer dans une pensée à un moment donné.
Ceci illustre un conflit actuel entre la « Big Science » et les chercheurs qui privilégient une approche plus mécanistique. Raoult, ne se sentant d’aucune école en particulier, utilise les outils pour satisfaire sa curiosité et non pour participer à un mouvement gigantesque. « D’ailleurs quand les mouvements s’affirment, prennent trop de place et que trop de monde y travaille, je m’en écarte généralement pour essayer de trouver un chemin que n’est encore pas, ou peu, fréquenté car il y a plus de choses à découvrir. Nous vivons un moment critique ou nous voyons passer sous nos yeux des milliards de données et pas beaucoup de pensées. »
IV. Interprétation et Causalité en Science
1. Complexité de la Causalité
En sciences, attribuer des causes simples à des phénomènes complexes peut être problématique. La recherche en psychiatrie, qui cherche souvent une seule cause pour une maladie, est un bon exemple de cette simplification excessive. Freud cherchait un événement unique dans l’histoire du patient, mais la réalité est bien plus nuancée. Les interactions entre un virus, la quantité et les variantes du virus, l’hôte, l’âge, l’environnement et les facteurs génétiques (interaction GxE) illustrent la complexité de la causalité dans le domaine médical.
2. Causalité Simplifiée
Jacques Monod a observé : « Ce qui est vrai pour E. coli est vrai pour l’éléphant ». Cela est bien trop simple et réducteur. Cette approche réductionniste, en se concentrant sur un seul facteur explicatif, peut négliger des milliers de variables internes qui régulent les phénomènes biologiques chez les humains. Cela est particulièrement vrai dans des modèles simplifiés comme ceux des cellules ou des animaux, qui ne peuvent souvent pas être extrapolés aux humains. Les humains ont des milliers de variables internes de régulation. Plus on réduit le nombre de paramètres contrôlés dans une étude, plus la variation apportée par les paramètres non contrôlés est importante. C’est pourquoi deux études similaires dans des conditions différentes peuvent donner des résultats différents, car chaque facteur non contrôlé influe sur le résultat (par exemple, la nourriture, l’environnement, les lieux, etc.). Même au sein du même institut, deux groupes n’arrivent pas toujours à retrouver les mêmes résultats et à développer le même modèle.
3. Les Principes de Robert Koch et la Tuberculose
Le médecin allemand Robert Koch a tenté d’organiser la pensée sur la causalité de la tuberculose. Il postulait que le bacille de Koch était la cause de la tuberculose parce qu’on pouvait l’isoler chez les patients atteints et parce qu’en l’injectant chez l’homme, on retrouvait des lésions qui étaient celles de la tuberculose. Bien entendu, la réalité est plus complexe et n’est jamais aussi simple. Par exemple, il faut se rendre compte que les comparaisons entre fumeurs et non-fumeurs ne suffisent pas car elles ne tiennent pas compte des différences de métabolisme, d’habitudes, de comportement général, et de susceptibilité génétique à l’addiction, qui sont de nombreux facteurs de confusion.
4. Limites des Études Statistiques
La différence significative en statistique ne fait pas tout. Elle ne traduit pas toujours une causalité véritable. En effet, la signification statistique indique simplement que les résultats obtenus sont peu susceptibles d’être dus au hasard (95%), mais cela ne prouve pas que ces résultats reflètent une relation causale entre les variables étudiées.
L’importance de la taille de l’échantillon est cruciale :
- Petits échantillons : Avec peu de participants, une étude peut échouer à détecter des effets qui sont réellement présents, simplement parce que la variabilité aléatoire masque les effets réels.
- Grands échantillons : Inversement, des échantillons très larges peuvent révéler des différences statistiquement significatives même pour des effets minimes qui ne sont pas cliniquement pertinents. Ces résultats peuvent être trompeurs, car ils semblent indiquer une importance que les données réelles ne justifient pas.
- Plus on multiplie les questions, le nombre de tests et le nombre de participants, plus on a de chance d’observer une différence significative. Ainsi un groupe de 100000 participants avec une différence de 49.75% vs 50.25% pourrait être significatives, même si cela ne veut rien dire.
Ce problème est exacerbé dans le contexte de la « big science », où des études portant sur de vastes ensembles de données et de nombreuses variables peuvent aboutir à des conclusions questionnables. Par exemple, l’analyse de multiples facteurs alimentaires et leur corrélation potentielle avec diverses maladies, comme le cancer, peut conduire à identifier des liens qui sont statistiquement significatifs mais qui n’impliquent pas nécessairement une relation causale.
Dans de tels cas, même avec une grande rigueur méthodologique, le risque de trouver des corrélations faussement significatives augmente avec le nombre de comparaisons effectuées. En effet, plus on multiplie les tests, plus la probabilité de découvrir par hasard au moins une association significative s’accroît. Cela peut mener à des publications suggérant des effets protecteurs ou déclencheurs sur la santé pour des aliments comme les brocolis ou les haricots, alors que ces effets sont en réalité négligeables ou inexacts. Tout ceci est dérisoire et ridicule car les différences sont trop subtiles et non la plupart du temps aucun intérêt parce qu’elles sont fausses.
5. La Notion de Seuil en Médecine
Définir un « seuil » de risque en médecine est souvent trompeur car les groupes étudiés sont souvent hétérogènes. L’idée qu’il existe un risque au-dessus d’un certain seuil et aucun en dessous est souvent une simplification excessive. Par exemple, les cirrhoses du foie sont fortement associées à la co-infection par les virus des hépatites B et C et l’obésité joue un rôle de cofacteur important, tandis que l’alcool à lui seul n’est souvent pas suffisant pour causer la lésion.
V. L’Évolution de la Science au XXe Siècle : Popper et Kuhn
1. Karl Popper : Le Rôle de l’Ignorance et le Principe de Falsifiabilité
Karl Popper a introduit le principe de falsifiabilité, affirmant que toutes les théories scientifiques doivent être susceptibles d’être contredites à un moment ou à un autre. Pour Popper, une théorie qui ne peut être mise à l’épreuve par une expérience potentielle qui montrerait qu’elle est fausse relève plus de la croyance ou de la religion. Initialement, Popper a critiqué des théories comme le marxisme, la psychanalyse, et même la théorie de l’évolution de Darwin pour leur manque de falsifiabilité, bien qu’il ait par la suite modifié son jugement sur cette dernière.
Examen des Trois Théories selon Popper :
- Marxisme : Critiqué pour son adaptabilité rétrospective qui permet d’expliquer tout résultat historique sans possibilité de réfutation, rendant la théorie non falsifiable.
Le marxisme, tel qu’originellement formulé par Karl Marx, prévoit inévitablement des luttes de classes conduisant à la révolution du prolétariat et à l’établissement d’une société sans classes. Popper critique le marxisme pour son adaptabilité rétrospective aux événements historiques, ce qui le rend difficile à falsifier. Par exemple, si une révolution prolétarienne échoue ou ne se produit pas, les marxistes peuvent attribuer l’échec à des « facteurs non anticipés » ou à des « conditions pas encore mûres ». Cette capacité à expliquer tout résultat historique sans possibilité claire de réfutation fait du marxisme, selon Popper, une théorie non scientifique.
- Psychanalyse : Capable d’interpréter tout comportement humain de manière plausible après le fait, sans possibilité de prédiction spécifique et testable, donc non falsifiable.
La psychanalyse, en particulier celle de Freud, propose des explications sur la façon dont les comportements conscients et inconscients sont influencés par des processus psychologiques cachés. Popper critique la psychanalyse car elle peut interpréter de manière plausible tout comportement humain après le fait. Par exemple, si une personne évite les relations, cela peut être interprété comme une peur de l’intimité due à des expériences enfantines, et si elle recherche activement des relations, cela peut aussi être expliqué par un besoin de compenser un manque infantile. Cette capacité à justifier n’importe quel comportement humain sans prévoir de manière spécifique et testable ce que l’on devrait observer rend la psychanalyse non falsifiable et donc non scientifique selon Popper.
- Théorie de l’Évolution de Darwin : Initialement jugée trop large pour être testée de manière rigoureuse, mais plus tard reconnue par Popper comme partiellement falsifiable à travers des prédictions spécifiques sur les changements génétiques et phénotypiques.
La théorie de l’évolution par sélection naturelle propose que les traits avantageux pour la survie et la reproduction tendent à être préservés, tandis que les traits désavantageux sont éliminés. Initialement, Popper a exprimé des réserves quant à la falsifiabilité de cette théorie, la considérant trop large pour être testée de manière rigoureuse. Cependant, il s’est rétracté plus tard, reconnaissant que certains aspects de la théorie, comme les prédictions sur les changements génétiques et phénotypiques au fil du temps dans des populations isolées, pouvaient être testés et potentiellement falsifiés. Des exemples incluent des prédictions sur la distribution des traits dans des populations soumises à des pressions environnementales spécifiques, qui peuvent être confirmées ou infirmées par des observations et des expériences.
Ces discussions montrent comment le critère de falsifiabilité de Popper est utilisé pour évaluer si ces théories peuvent être considérées comme scientifiques. En général, pour Popper, une théorie doit permettre de prédire des événements qui, s’ils ne se produisent pas, peuvent clairement réfuter la théorie.
2. Popper et l’Importance des Outils dans la Découverte Scientifique
Karl Popper a également souligné que la découverte scientifique dépend souvent de la disponibilité de nouveaux outils. Il a illustré comment des avancées majeures comme la révolution géographique avec l’apparition des bateaux et des boussoles, l’astronomie avec les télescopes, et la microbiologie avec les microscopes ont transformé notre vision du monde. Selon Popper, le changement d’outils entraine un changement des observations et nous oblige à réviser et adapter nos théories, soulignant ainsi leur rôle crucial dans l’évolution des connaissances scientifiques.
L’évolution de la science (même si les scientifiques doivent avoir un motif pour regarder, uen induction) est due aux scientifiques qui participent aux nouvelles découvertes permises par ces outils, car le mobile le plus important de ces scientifiques est la curiosité.
3. Thomas Kuhn : Le Paradigme Scientifique et les Révolutions
Thomas Kuhn a exploré comment les paradigmes scientifiques évoluent à travers des révolutions. Il souligne que la science commence souvent avec des découvertes pionnières durant une période de révolution scientifique. À mesure que les nouvelles découvertes diminuent, dû à la diminution de la proportion à découvrir avec le nouvel outil ou le nouveau paradigme, la science entre dans une phase de « science normale » où l’accent est mis sur l’amélioration graduelle des connaissances existantes, plutôt que sur des remises en question radicales. Finalement, une phase de stagnation s’installe où les chercheurs deviennent les gardiens du temple, du paradigme existant, jusqu’à ce qu’un nouveau bouleversement provoque une nouvelle révolution.
En résumé, les travaux de Karl Popper et Thomas Kuhn offrent des perspectives essentielles sur la manière dont les sciences évoluent, mettant en lumière l’importance de la falsifiabilité, des révolutions paradigmatiques, et de l’instrumentation dans le progrès scientifique.
VI. L’édition scientifique : entre commerce et rigueur académique
Il existe deux types principaux dans l’industrie de l’édition scientifique : d’un côté, des entités comme Elsevier (The Lancet), Macmillan (Nature), Wiley-Blackwell, qui cherchent à générer des profits et privilégient donc les articles susceptibles de faire sensation. De l’autre, les revues appartenant à des sociétés scientifiques où le risque est différent : elles peuvent réticentes à publier des travaux qui ne correspondent pas aux courants majeurs de pensée de la société concernée.
Il y a également des difficultés à approuver des publications contenant des éléments intéressants mais dont l’anglais est mauvais ou la présentation inhabituelle pour les éditeurs, du fait qu’elles proviennent de cultures différentes. Publier dans certaines revues comporte aussi un facteur chance.
Charles Péguy disait : « Les commencements ont une vertu que l’on ne retrouve plus jamais. » Les débuts s’accompagnent d’un esprit pionnier, ouvert. Mais quand cela devient un enjeu majeur, une deuxième génération moins pionnière et se prenant plus au sérieux peut commencer à « défendre le temple ». Il suffit de quelques années pour transformer une aventure initiale en quelque chose qui ressemble à une académie.
Le format actuel des articles impose des contraintes : l’histoire telle qu’elle est publiée ne représente jamais la réalité ; elle est reconstruite. En réalité, la stratégie se bâtit au fur et à mesure des résultats, et l’objectif change souvent au cours des expérimentations. Ainsi, l’introduction (donnant un sens initial aux choses), puis les méthodes, les résultats, et la discussion ne reflètent jamais la réalité, avec des discussions souvent construites a posteriori, basées sur des résultats inattendus. La version initiale donne à l’ensemble un aspect intelligent et intelligible, perpétuant la légende d’une recherche préprogrammée. Cette vision est en résonance avec la distribution des financements, qui sont octroyés sur la base de projets de recherche fondés sur des hypothèses. En réalité, la plupart des projets ne se déroulent jamais comme prévu. Aujourd’hui, en Europe et en France, les organismes de financement veulent vérifier que l’argent sert bien aux projets financés. Cependant, cela ne fonctionne jamais ainsi ; c’est une vision délirante de l’administration. En effet, le temps que nous déposons le projet, la science a continué à évoluer et certaines questions ont radicalement changé. Bien sûr, l’argent doit être utilisé pour suivre les grandes lignes du domaine pour lequel il a été demandé, mais il faut être très prudent dans cet enfer administratif qui demande des étapes et des expériences précises correspondant à la version initiale du projet.
VII. Pourquoi publier ses recherches ?
Publier permet de diffuser nos résultats dans la société qui finance notre production scientifique, remplissant ainsi notre part du contrat. C’est un art difficile consistant à soumettre son travail à des rapporteurs anonymes, ce qui signifie, dans la plupart des cas, la possibilité de voir son travail démonté par un concurrent direct. Si vous survivez à cette évaluation, alors votre travail a une certaine solidité. Parfois, les rapporteurs sont négatifs parce qu’ils n’aiment pas votre travail, parfois en raison de la concurrence directe. Par chance, une autre revue pourrait accepter si les rapporteurs sont différents – ce sont les règles du théâtre. Cette évaluation par les pairs est un tel enjeu qu’elle nous rend plus efficaces : souvent, les rapporteurs soulèvent des questions pertinentes et nous obligent à examiner les choses d’une manière différente. Écrire une publication apporte beaucoup, car cela oblige à rendre compréhensible la recherche que nous faisons, tout en acceptant les critiques anonymes et en tentant de les contourner ou de les intégrer si elles sont utiles.
VIII. Conclusion
« L’amour que j’ai pour la littérature et la créativité m’inspire quotidiennement. La séparation étanche du monde des sciences dites dures, des sciences humaines et de la créativité littéraire est une mauvaise chose. Le cantonnement dans sa propre réalité ne permet pas la hauteur de vue nécessaire pour réanalyser les choses. C’est pourquoi les philosophes, poètes et écrivains inspirent et permettent d’analyser les choses de façon pertinente et tente de les comprendre. »
Prof. Raoult prône également la lecture d’œuvres classiques, qui ont été trié par le temps— des grands noms de la littérature française aux auteurs étrangers renommés. Il évoque par exemple « La bibliothèque idéale » de Bernard Pivot et les listes de lectures recommandées par des institutions telles que Harvard et Stanford comme sources d’inspiration. « La Métamorphose » de Franz Kafka, en particulier, résonne avec lui pour son exploration de la transformation, un thème aussi central en science.
En définitive, Didier Raoult nous rappelle que la science, pour être véritablement innovante et pertinente, doit rester ouverte aux influences extérieures, y compris celles qui proviennent de domaines apparemment éloignés comme la littérature. C’est en embrassant cette richesse interdisciplinaire que la science peut espérer dépasser ses propres limites et continuer à progresser.
IX. Théorie de l’Évolution : Une Vision Complexe et Interconnectée
1. Les Mécanismes de l’Évolution : Lamarck et Darwin
L’évolution biologique a longtemps été comprise selon deux grands paradigmes :
- Lamarckisme (environ 2/3 des gènes) : Dans cette vision, l’adaptation précède la modification génétique. Les organismes ajustent leurs caractéristiques en réponse à leur environnement, et ces changements peuvent se transmettre aux générations suivantes. Par exemple, certains gènes, s’ils ne sont pas nécessaires dans un environnement donné, ne sont pas exprimés et peuvent finir par disparaître au fil des générations.
- Darwinisme (environ 1/3 des gènes) : Selon Darwin, les variations génétiques surviennent aléatoirement. La sélection naturelle fait en sorte que les individus présentant des traits avantageux dans un environnement donné survivent et se reproduisent. Ce processus repose donc sur le hasard (les mutations génétiques) et la nécessité (la sélection du plus apte). Cependant, Darwin n’a pas intégré la notion d’événements chaotiques, qui introduisent des variations imprévisibles dans l’évolution.
2. Au-delà de la Génétique : Les Limites du Gène dans l’Évolution
Les gènes ne déterminent pas tout dans l’évolution. Par exemple :
- Facteurs environnementaux et comportements acquis : Les enfants adoptés de parents obèses montrent souvent une prédisposition à l’obésité, soulignant le rôle de l’environnement au-delà de la seule génétique.
- Systèmes immunitaires affaiblis : La diminution de l’exposition aux parasites dans notre environnement moderne a conduit à une hausse des allergies. L’absence de stimuli immunitaires « naturels » affaiblit notre système de défense.
3. Une Nouvelle Vision de l’Arbre de Vie : Le Rhizome
Les organismes vivants ne forment pas un arbre généalogique simple et linéaire. Le biologiste Didier Raoult (2021) propose une vision rhizomique de l’évolution, où les branches s’entrecroisent et proviennent d’origines multiples (Rhizomal Reclassification of living organisms 2021 Raoult). Cette vision, d’individus mosaïques, représente les origines diverses des espèces et illustre une réalité plus complexe que celle d’un ancêtre unique.
Cette théorie remet en cause l’idée d’un ancêtre commun unique, notamment du a ces réalités :
- Recombinaisons entre espèces : L’Homo sapiens, par exemple, partage des gènes avec Néandertal, comme ceux liés aux yeux bleus ou au teint clair.
- Mosaïques eucaryotes : Les mitochondries, organites essentiels responsables de la production d’énergie dans nos cellules, proviennent de bactéries qui, il y a un milliard d’années, ont parasité des cellules eucaryotes.
- Composition des cellules humaines : Nos cellules sont un mélange de bactéries et de proto-eucaryotes, témoignant de cette mosaïque de composants génétiques.
4. Spécialisation et Toxicité : Le Cas des Bactéries
Les bactéries, souvent perçues comme toxiques, deviennent dangereuses principalement par la perte de certains gènes. Cette perte les rend hyperspécialisées, augmentant leur capacité à causer des dommages. La toxicité n’est donc pas toujours liée à la nature de la bactérie elle-même, mais à son évolution vers une spécialisation extrême.
5. Les Séquences Non Codantes : Une Clé de l’Évolution
Le génome humain contient environ 70 000 rétroposons – des séquences issues d’anciens rétrovirus intégrés dans notre ADN. C’est un processus de « cannibalisation » dans lequel de génome cannibalise celui du virus et ainsi le neutralise, ce qui permet a l’individu de devenir résistant aux virus/ennemis identiques car il peut maintenant les reconnaitre. Ce processus de « cannibalisation » des virus par le génome est aussi observé chez d’autres organismes (comme le Ver Brugia malayi …), où des séquences bactériennes (Wolbachia bacteries) sont intégrées puis neutralisées, servant des fonctions biologiques.
Ces rétroposons ont un rôle fondamental dans des fonctions essentielles, comme la formation du placenta. Par exemple, cette infection rétrovirale n’a pas eu lieu en Australie, expliquant pourquoi les marsupiaux n’ont pas de placenta.
6. Les Différences entre l’Homme et le Singe : Les Séquences Non Codantes
Les différences génétiques entre l’homme et les singes résident surtout dans les séquences non codantes répétées, qui influencent l’expression de certains gènes, notamment ceux liés aux neuromédiateurs. 90% du genome humain et non codant, alors que seulement 1% du genome humains code pour des proteines.
7. Conditions pour la Survie d’un Organisme
Pour survivre, un organisme doit répondre à trois critères :
- Capacité de reproduction (gènes).
- Écosystème adapté (environnement).
- Timing adéquat pour les adaptations nécessaires.
La Répétition de Séquences : Un Moteur de l’Évolution
Les séquences génétiques qui se répètent jouent un rôle central dans l’évolution. Ces séquences, d’origine externe, peuvent être intégrées dans un organisme si elles ne présentent pas de danger apparent. Une fois intégrées, elles peuvent être « utilisées » par l’organisme, influençant son développement de façon significative.
Échange de Gènes : Conditions pour Intégration
L’échange de gènes nécessite :
- Proximité dans l’écosystème : Les organismes doivent vivre en promiscuité.
- Tolérance : La séquence échangée ne doit pas provoquer de réactions de défense.
- Utilité : La séquence doit être exprimée ou servir une fonction, sans quoi elle sera éliminée.
8. L’Évolution : Entre Hasard, Nécessité et Chaos
L’évolution est liée au hasard et au chaos, non pas au hasard et à la nécessité.
Par exemple, chez les organismes multicellulaires, une grande partie du génome est constituée de séquences non codantes de type parasitaire (98 %). Ces éléments influencent profondément la biologie des organismes et montrent que l’évolution pourrait être perçue comme une épidémie de séquences, souvent propagées par des virus ou des transposons, et qui se répètent sans cesse. Nous avons des épidémies de séquences qui ont une origine externe et une amplification interne.
Origines des Cellules Eucaryotes
On suppose qu’un ancêtre des cellules eucaryotes, appelé proto-eucaryote, n’avait pas de mitochondries. Il y a plusieurs millions d’années, l’intégration du génome mitochondrial a donné naissance à la cellule eucaryote moderne. Cette cellule a ensuite été parasitée par des gènes d’amibes, entraînant des variations génétiques et une diversification. Les eucaryotes multicellulaires sont ainsi devenus la proie de parasites (plasmides, virus, séquences isolées), qui provoquent soit des infections fatales pour la population, soit, par hasard, permettent la survie d’individus devenus résistants par cannibalisme génétique.
9. Conclusion : Une Réflexion sur l’Évolution et la Société
L’évolution est façonnée par des événements aléatoires et chaotiques, tout comme les sociétés humaines. Ces dernières peuvent entrer en déclin lorsqu’elles perdent leur capacité à produire au profit d’une majorité de travailleurs tertiaires. En France, par exemple, 80 % de la population active est dans le secteur tertiaire, ce qui peut constituer une fragilité pour la civilisation.
10. COVID-19 : Exemple d’Évolution Virale
Le COVID-19 a commencé en Chine avant de se répandre en Europe, où deux mutations critiques sont apparues :
- ARN polymérase (responsable de la réplication du virus).
- Spike (protéine d’adhésion aux cellules humaines).
Ces mutations ont augmenté le taux de mutation et d’adhésion du virus, favorisant sa propagation. Une enzyme appelée APOBEC, censée être une défense immunitaire, a également favorisé des mutations virales. Ce sont ces évolutions qui ont contribué à transformer le COVID-19 en pandémie.
X. Les livres de Prof. Raoult
- Pour acheter et lire Homo Chaoticus : https://amzn.to/3Qt5bbx
- Pour obtenir La science est un sport de combat : https://amzn.to/437MMbC
Je t’invite à me suivre pour recevoir d’autres articles et vidéos sur la thèse :
Et n’oublie pas, nous sommes de vaillants doctorants prêts à se donner les moyens de réussir notre thèse !
À cœur vaillant, rien d’impossible !
Cyprien
Créez votre projet de recherche et obtenir le financement
Pour aller plus loin, j’ai rédigé un livre à ce sujet. j’y partage tout ce que j’ai appris jusqu’à aujourd’hui lorsque j’ai obtenu mes financements pour mon doctorat et pour mon projet de Rubicon de postdoctorat.
L’objectif est de vous donner les clés pour rédiger des projets de recherche solides, rigoureux, innovants et pertinents, qui captiveront les comités de lecture et maximiseront vos chances de financement.
Nous y voyons comment :
- Développer votre esprit critiques pour repérer les bonnes idées des mauvaises.
- Transformer des projets de recherche chaotiques en propositions ordonnées et convaincantes.
- Se préparer à naviguer dans le paysage complexe de le recherche scientifique, avec des conseils stratégiques et pratiques pour avancer avec assurance.
- Economiser du temps et éviter les erreurs communes.
Je vous partage des exemples concrets de mes propres projets de recherche.
En pratique, le livre est organisé en 6 grands chapitres :
- Introduction aux Projets de recherche – Fournir une compréhension fondamentale des projets de recherche, y compris les différents types de recherche et les étapes clés du processus de recherche.
- Génération d’idées et créativité en recherche – Apprendre à générer des idées de recherche innovantes et créatives, et à développer des approches originales pour aborder les questions scientifiques.
- Optimisation du CV et préparation personnelle – Équiper les participants avec les compétences nécessaires pour optimiser leur CV et leur préparation personnelle, les rendant plus compétitifs pour les opportunités de financement.
- Rédaction et soumission du projet de recherche – Enseigner comment rédiger et soumettre efficacement des propositions de recherche pour maximiser leurs chances de succès et d’obtention de financement.
- Stratégie pour un projet de recherche réussi – Stratégies avancées et des techniques concrètes pour rédiger et soumettre des propositions de recherche qui maximisent les chances de financement et d’acceptation.
- Maitriser l’art de l’écriture scientifique – Équiper les participants avec des techniques avancées de rédaction scientifique pour améliorer la qualité, la clarté et l’impact de leurs écrits.
En lisant ce livra tu apprendra comment passer de l’idée chaotique au projet de recherche ordonné et rédigé.
👉 Accède ici au livre sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0DZ2HMGN1
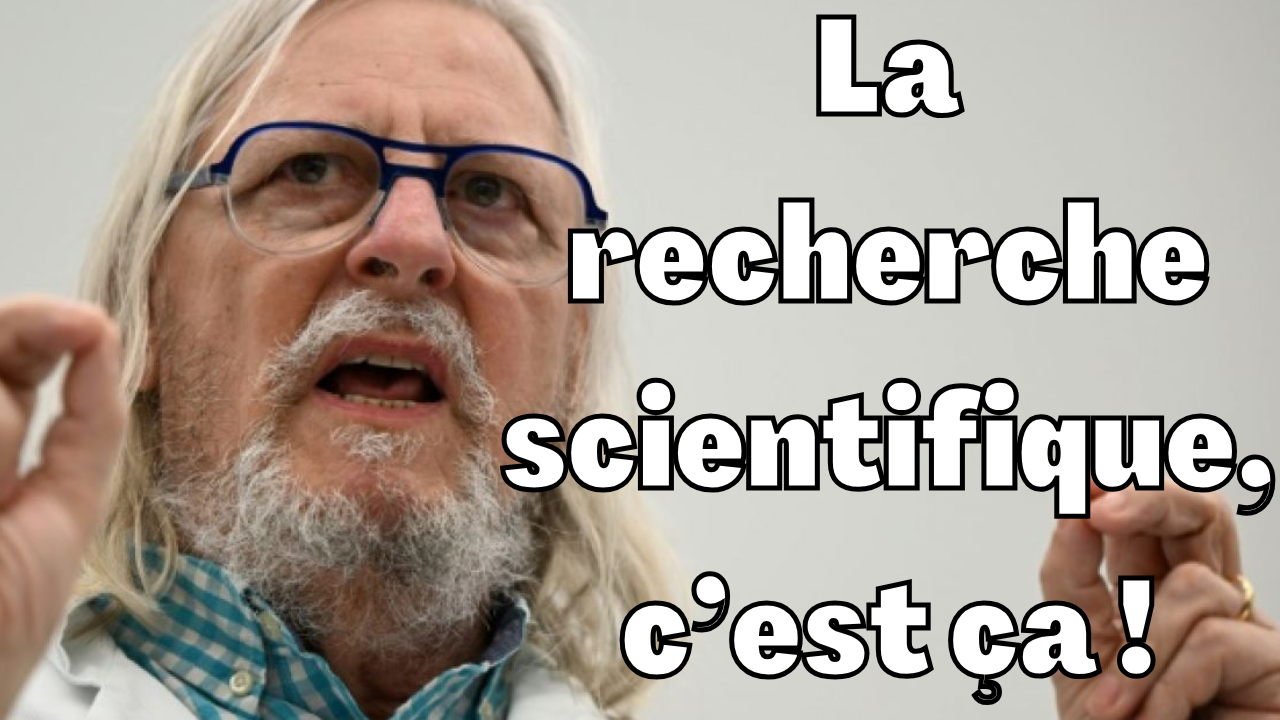


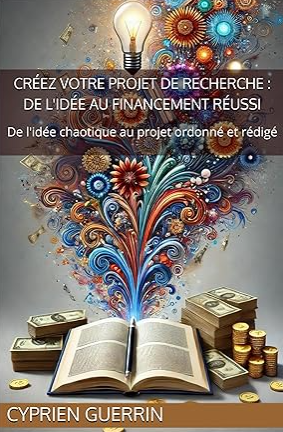
Donne moi ton avis en commentaires !